ch:mg : Bonjour Marie Ranjanoro. Vous êtes une écrivaine malgache, née à Antananarivo en 1990. Vous avez étudié à l’IEP d’Aix-en-Provence en France, où vous avez notamment travaillé sur la figure de zombie. Pendant un temps, vous vous êtes dirigée vers la finance solidaire, puis, ensuite, vers l’activité littéraire, avec Feux, fièvres, forêts. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à cette présentation ?
Marie Ranjanoro : Oui, exactement ! Excepté que c’était de la finance très social washing…Cela m’a beaucoup beaucoup dégoûté de ce milieu, qui n’a de solidaire que le nom. J’y ai travaillé 5 ans en arrivant, douloureusement, à la conclusion qu’on ne peut pas soigner le capitalisme avec plus de capitalisme.
ch:mg : Justement, qu’est-ce qu’il y a déclenché l’écriture de Feux, fièvres, forêts ? L’écriture d’un tel roman peut paraître surprenante, autant au regard de votre parcours universitaire que par rapport au sujet en lui-même, qu’on pourrait regarder au premier abord comme un événement assez obscur de l’histoire française et malgache.
M. Ranjanoro : En fait, j’ai toujours été attirée par les lettres. Dès le primaire, je m’impliquais dans le journal de l’école, j’ai participé à tous les concours de poésie possibles. J’ai obtenu un Bac L, puis j’ai fait une classe préparatoire littéraire avant d’intégrer Sciences Po. Et justement, j’ai écrit là-bas ce mémoire, qui fait le lien, dans le contexte américain, entre la lutte pour les droits civiques et le rapport à l’immigration notamment haïtienne d’un côté, et le cinéma d’horreur américain de l’autre. C’est plutôt la finance qui est une erreur de parcours : après trois ans et demi, j’ai commencé à me poser des questions et à me dire que ce que je faisais n’avais pas beaucoup de sens. Finalement, j’ai tout laissé pour me consacrer à l’écriture. J’ai d’abord débuté un podcast, Basy Vavy1, avec ma meilleure amie Hoby Ramamonjy, qui explore le féminisme à travers le regard de la diaspora malgache. On a interviewé les femmes malgaches sur des thèmes comme le travail ou la maternité, avec un accent fort sur le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur temps. Il faut savoir que la législation malgache est l’une des plus dures au monde sur l’avortement, c’est-à-dire que même l’interruption thérapeutique de grossesse — lorsque la vie de l’enfant ou de la mère est en danger — n’y est pas légale2.
C’est quelque chose qui s’explique aussi par mon parcours scolaire. J’ai fréquenté les écoles françaises à Madagascar, dans lesquelles les élites malgaches envoient leurs enfants, et qui sont une permanence du colonialisme. Dans ces écoles-là, on suit le même cursus que les enfants français ; en cela, je suis aussi un produit colonial. Et justement, l’histoire coloniale prend y prend très peu de place : je n’ai eu connaissance de 1947 qu’en terminale, par le biais de ma professeur d’histoire, qui, contre l’avis du Conseiller d’action culturelle et de l’ambassade de France, avait organisé un colloque dans mon lycée en invitant des grandes pointures de l’histoire malgache : Françoise Raison-Jourde, Jean Fremigacci et Solofo Randrianja. C’est dans ce colloque que j’en entends parler pour la première fois, ce qui est très grave à 17 ans, quand on est de nationalité malgache et qu’on a grandi à Madagascar. J’y découvre plus précisément l’histoire de Telonono, cette insurgée qui aurait eu des pouvoirs magiques et qui était à la tête d’une faction de bandits. C’est à ce moment-là que je réalise que le rapport de domination entre colons et colonisés ne s’exerçait pas sans résistance : il y a eu des figures insurrectionnelles, qui ont vraiment menacé le pouvoir colonial. 1947, c’est une révolte qui a été écrasée dans le sang, mais avec un rapport de force très inégal entre les deux camps, et donc, pour la première fois, je constate que la France a eu très peur. Ça renverse le rapport même du point de vue épistémique : les traces qu’on a de l’histoire coloniale, c’est les traces du vainqueur, dont la culture d’archives est, de fait, plus à même de servir d’assise au récit historique, puisqu’elle n’est pas tributaire de la transmission orale, beaucoup plus fragile, fine et difficile à assurer.
« Le rapport de domination entre colons et colonisés ne s’exerçait pas sans résistance : il y a eu des figures insurrectionnelles, qui ont vraiment menacé le pouvoir colonial. 1947, c’est une révolte qui a été écrasée dans le sang, mais avec un rapport de force très inégal entre les deux camps, et donc, pour la première fois, je constate que la France a eu très peur. »
L’histoire de Telonono me reste en tête pendant des années jusqu’à ce que je rencontre Marie-Clémence Andriamonta en 2019, qui est mon éditrice aujourd’hui. À ce moment-là, elle venait de sortir son film « Fahavalo, Madagascar 1947 », pour lequel elle a enquêté sur les conditions d’emprisonnement de son grand-père durant la répression de l’insurrection. Une des premières archives qu’elle a examiné, c’était un signalement de recherche pour une insurgée, où il est vraiment écrit, noir sur blanc : « Recherche femme betsimisaraka3, de 26 à 27 ans, sorcière de profession, avec un sein à gauche et deux seins à droite ». Toutes les deux, cette archive nous a touché et nous a rassemblé, parce qu’on sentait un lien identique avec cette femme-là qui a vécu il y a 80 ans. À ce moment-là, je n’avais pas l’ambition d’écrire sur 1947 parce que c’était vraiment un sujet que je trouvais trop chargé, et sur lequel je ne me sentais pas légitime d’écrire. Elle m’a alors proposé de partir de cette archive en particulier. Le livre est donc également l’histoire d’une rencontre aussi entre elle et moi.
chmg : Au cours de votre passage sur France Inter pour l’émission Affaires sensibles à l’occasion de la sortie du livre4, vous mettez très vite l’accent sur la continuité du fait colonial en mentionnant la répression ayant alors lieu à Gaza comme un autre massacre colonial. En effet, la configuration politique est entre les deux cas très semblable : une insurrection d’une partie de la population, suivie d’une répression extrêmement forte, utilisée au final comme prétexte pour raffermir l’emprise coloniale. Dans les deux cas également circulent des soupçons plus ou moins avérés de complot de la part du pouvoir colonial qui aurait laissé se dérouler ces révoltes pour mieux pouvoir organiser la répression. Comment vous regardez cette comparaison ?
M. Ranjanoro : C’est vrai qu’au moment de cette interview, on est en 2024, quelques mois après le 7 octobre. On était en plein dans les polémiques au sein de l’hémicycle, par rapport aux députés de la France insoumise qui dénonçaient le massacre colonial à Gaza, et qui étaient lourdement sanctionnés pour cela…
ch:mg : …Pour préciser la question, c’était encore à un moment où la situation médiatique n’était pas du tout la même qu’aujourd’hui5, et affirmer la dimension coloniale de ce massacre, c’était vraiment une prise de position.
M. Ranjanoro : Oui, c’était encore très minoritaire comme position. Cela m’avait vraiment rappelé cet épisode, où les députés malgaches avaient demandé par des voies légales et pacifiques l’indépendance de Madagascar. Ils l’ont fait en toute légitimité, puisque après la prise de parole de Brazzaville du général de Gaulle, on était en mesure de croire que cette indépendance était possible6. Et puis, ce n’était même pas une demande dans des termes très violents ou radicaux, elle se maintenait dans le cadre de l’Union française. Donc, il y avait un vrai désir d’assimilation. Cette voie légale a été réprimée, très fortement, puis ces mêmes députés se sont retrouvés ensuite mêlés à l’insurrection et emprisonnés. Ce fut vraiment une répression assez dure, alors que ces personnes-là étaient en principe des représentants au sein de l’Assemblée nationale.
D’ailleurs, au moment où je passe à Affaires Sensibles, il y a une révolte en Kanaky7, qui est aussi très marquante dans cette perspective. À la limite, on pourrait dire que Gaza, en France, reste une question de politique étrangère entre le peuple palestinien et l’entité sioniste. Pour la Kanaky, le parallèle est encore plus fort, puisque c’est encore aujourd’hui une colonie française, avec cette utilisation de l’outil référendaire8 pour essayer de trouver une espèce de sortie légale aux révoltes, mais qui est évidemment une manipulation on ne peut plus coloniale.


Je n’avais pas prévu de parler de Gaza immédiatement, mais j’avais les images sous les yeux, et le discours que je voulais porter, c’était celui du continuum du fait colonial. Ce fait colonial, ce n’est pas un objet historique isolé, qui existe dans un espace lointain par le prisme d’une espèce de distanciation « scientifique », qui vient juste nous empêcher de voir l’aspect sensible de la colonisation. Madagascar, malgré qu’elle soit décolonisée et indépendante depuis 1960, en réalité, n’est jamais vraiment sortie du giron français. Déjà, jusqu’en 1972, il y a une ingérence de la France jusqu’au plus proche du pouvoir : on retrouve même deux ministres français dans le premier gouvernement malgache11 ! Et c’est quelque chose qui continue aujourd’hui : Lors de sa visite cette année, le président Macron venait apparemment pour la restitution des restes des rois sakalava12, dans la continuité de ce débat autour de la mémoire coloniale. Mais il a également proposé la mise en place d’une commission mixte d’historiens, pour faire la lumière sur 1947 — ce qui est un peu étonnant puisqu’il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur le sujet. Pourquoi rouvrir une commission sinon pour dire, dans un genre de paternalisme, que les malgaches ne peuvent faire leur histoire eux-mêmes ? La présence des Français est donc nécessaire pour obtenir une neutralité ? Et puis, cette visite ne se fait pas simplement dans le cadre d’une amitié entre deux peuples égaux : elle a aussi pour arrière-plan la signature d’un contrat par EDF pour la construction d’un barrage hydroélectrique13, la revendication de la souveraineté française sur les Îles Éparses, ainsi que la perte récente de leur arrière-cour en Afrique. Je pense que c’est quelque chose qu’on doit garder en tête pour parler de ces événements « historiques », comme un éclairage sur la situation actuelle.
ch:mg : Vous parliez de distanciation scientifique ; justement, on pourrait avoir tendance à se représenter 1947 sur ce mode là, très historique et chronologique. Dans le roman, vous mettez au contraire l’accent sur une approche presque phénoménologique, par le biais de laquelle vous reconstituez des sensations, des affects, mais aussi une spiritualité et une sociabilité. Comment cet angle participe à la réappropriation de la mémoire de la révolte ? Et, en miroir, comment cette histoire « scientifique » a-t-elle pu, au contraire, participer d’une forme de dépolitisation et de spoliation de cette mémoire ?
M. Ranjanoro : J’étais en Algérie cette année, pour la commémoration des 80 ans des massacres du Constantinois14. Durant ma visite, un historien algérien, Hosni Kitouni, a dit quelque chose qui m’a beaucoup touchée : “Comment peut-on rendre compte du fait colonial en décrédibilisant ou en écartant la parole des colonisés ?”. Et c’est vrai qu’il y a une espèce de paternalisme, une posture dans le milieu de la recherche en histoire en France, qui décrédibilise le témoignage au profit de l’archive écrite et institutionnelle. Or, ces archives-là, c’est le discours institutionnel par essence, qui, forcément, raconte le fait colonial avec un prisme particulier.
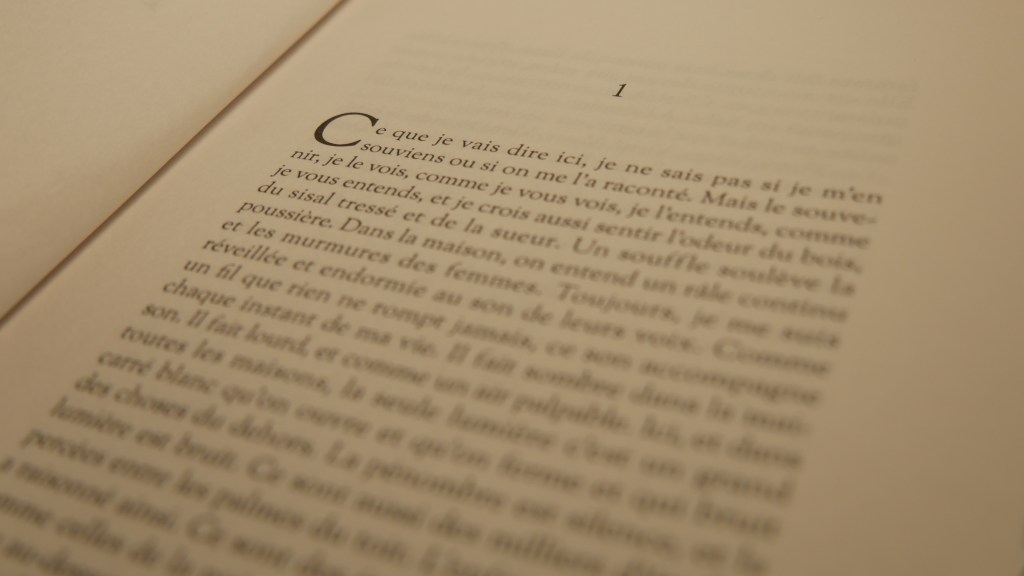
« Feux, fièvres, forêts », première page.
Moi, j’ai voulu au contraire toucher l’histoire sensible, avoir une approche micro-historique des faits. Lorsque l’on écarte le témoignage des gens qui ont vécu, dans leur chair et leur sang, phénoménologiquement comme vous le dites, la colonisation, on s’éloigne complètement du sujet. On le voit comme un « objet du passé », historique, statistique, économique…Or, c’est oublier que la colonisation a aussi été une violence sur les corps, une exploitation physique, sexuelle, une violence psychologique : il n’y a qu’à lire Fanon pour le comprendre. Réécrire cette histoire avec le roman, outil de la subjectivité, du « je », où on fait intervenir le monde sensible, les phénomènes qui se produisent sur un sujet, qui est agent et pas seulement objet d’étude, qui a une voix, des desseins, et qui n’est pas simplement la victime de ce qui lui arrive, c’est aussi remettre la focale sur des choses qui ont été écartées avec l’étude des traces écrites.
Et puis, il y a aussi le fait que je suis une femme, que j’écris sur un corps de femme racisée. Je voulais que le lecteur soit imprégné de ses sensations là, d’une expérience qui n’est pas universelle, mais que je peux rendre universelle à travers la voie du roman.
ch:mg : Ce qui est intéressant, c’est qu’on est imprégné de cette approche phénoménologique du point de vue d’une femme colonisée, mais qu’il y a un autre personnage, une sorte de némésis, le lieutenant Gallois d’Haurousse, pour qui l’approche est très semblable. On le lit frustré, complexé, honteux de la capitulation française en 1940, victimisé par ses supérieurs, se vengeant sur les colonisés qui croisent son chemin, non sans rappeler la narration d’un Robert Merle racontant le chef du camp d’Auschwitz, Rudolf Höß. Quel enjeu y-a-t-il à le présenter d’une telle manière, analogue à celle utilisée pour la protagoniste ?
M. Ranjanoro : C’est intéressant de le voir comme cela…D’abord, d’Haurousse porte l’intrigue principale : on peut retracer ce qu’il traverse dans le temps et dans l’espace assez clairement, tandis que tout le parcours de Voara est plus nébuleux, plus éclaté temporellement et spatialement. De mon côté, c’est un personnage que je n’ai jamais réussi à écrire à la première personne. Dans le projet initial du roman, je voulais écrire uniquement de son point de vue, pour que le lecteur ressente, à travers ce personnage, la peur qu’ont ressenti les Français, et rendre compte de cette inversion du rapport de force entre colon et colonisé. Ça me permettait aussi de sortir de la pure victimisation des colonisés et de montrer que la France avait subi sa propre violence, jusque dans sa chair. Les colons se font violence aussi à eux-mêmes en plus de s’imposer aux populations locales, puisque finalement, ça n’a jamais été un endroit auquel ils se sont vraiment adaptés.
ch:mg : Est-ce que, finalement, vous reprenez l’argument de Fanon ou de Césaire selon lequel autant le colonisé que le colon sont ensauvagés par le colonialisme ?
M. Ranjanoro : Oui, c’est exactement ce point de vue : La colonisation, sous le prétexte d’une mission « civilisatrice » — bien qu’il n’y ait rien à civiliser puisqu’il y a déjà une civilisation locale — décivilise le colon, parce qu’elle lui fournit l’autorisation suprême pour agir de la façon la plus « primaire ». Sur place, c’est le colon qui va se comporter comme il se représente lui-même l’indigène, comme un barbare ou un sauvage. Il devient le fantasme qu’il a projeté sur le colonisé.
« La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, […] à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence. Chaque fois qu’il y a au Viêt-Nam une tête coupée, et qu’en France, on accepte, un Malgache supplicié, et qu’en France, on accepte, il y a […] une régression universelle qui s’opère, une gangrène qui s’installe, un foyer d’infection qui s’étend. Au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent. »
Aimé Césaire, Discours sur le Colonialisme, 1955, p.77.15
Or, il est difficile de sortir indemne de ce processus, puisque la violence marque aussi le corps de celui qui la pratique, certes pas de la même façon. La France sentira pour l’éternité le stigmate cette histoire violente, parce que c’est son histoire aussi. C’est pour cela que je tenais aussi à rappeler que cet impact sur les corps et sur les esprits, c’est comme une marque qui a été imprimée dans son histoire : elle ne peut pas simplement s’en laver les mains.
ch:mg : Cet angle décolonial, vous le croisez aussi avec une perspective féministe, ce qui permet de prendre le contre-pied d’une vision angélique des femmes colonisées. A contrario, par exemple dans le cadre du décompte des victimes du génocide en Palestine, on a vu se multiplier les discours déplorant la mort de femmes et d’enfants, instituant de fait les premières comme des victimes innocentes par essence. Quel enjeu y avait-il pour vous a aborder également 1947 dans cette perspective féministe, et quelle est la singularité de cette perspective au regard de l’approche décoloniale qui la complète ?
M. Ranjanoro : Je ne pense pas que j’aurais pu écrire quelque chose qui ne soit pas féministe, parce que le livre est beaucoup nourri de recherches et de prises de position sur le sujet que j’avais déjà articulé avant même d’écrire. Justement, le titre de notre podcast, Basy Vavy vient une expression en malgache, à l’origine péjorative, une insulte qui veut littéralement dire « fusil bouche ». Elle est utilisée pour décrire une femme qui est vocale, bruyante, qui n’a pas peur de parler et qui dérange l’espace public. On a repris ça à notre compte : « fusil bouche », c’est une posture extrêmement positive, parce que cela montre qu’il y a une tradition de femmes malgaches qui n’ont pas peur de parler.
Ma vision du féminisme est d’abord malgache, et elle est liée de manière très étroite avec l’anticolonialisme, ce sont deux choses qui marchent côte à côte. La thèse qu’on soutient dans Basy Vavy, c’est que la place de la femme malgache était beaucoup plus importante avant la colonisation, et que la situation était beaucoup plus proche de l’égalité qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les missionnaires lazaristes et jésuites, venus à Madagascar avant la colonisation, montrent dans leurs écrits qu’ils sont horrifiés par le niveau de liberté qu’on les femmes, qui choisissent leurs amants, qui ne sont pas enfermées dans les liens du mariage, qui ont une vie sexuelle extrêmement libre, qui ne reçoivent pas d’autorité directe des hommes… Avant la colonisation, la transmission du nom de famille se fait par la mère, la famille de la mère est plus importante dans les décisions qui concernent l’enfant, et les terres sont transmises aussi par la mère. Il y a ce parti pris, déjà, de dire que la colonisation a renforcé, voire apporté un patriarcat à Madagascar. Pareillement, l’évangélisation a imposé cette domination du masculin sur le féminin, voire finalement même cette binarité, qui n’avait pas beaucoup de sens auparavant.
Il y a donc un féminisme intrinsèque à la culture malgache, qui préexistait à la colonisation, et ça n’est pas à tout prix de l’Occident que doit venir l’émancipation féminine. On retrouve vraiment aujourd’hui ce discours, selon lequel c’est l’Occident qui viendrait libérer les peuples soumis à un joug arriéré et obscurantiste, exactement comme Israël qui prétend défendre les droits LGBT sur le territoire palestinien… D’abord, on vous demande rien ! Et en plus, dans la globalité de ses manifestations historiques, c’est plutôt les colons et l’Occident qui ont amené ce puritanisme, et qui ont mis en danger les communautés queer ou non binaires qui pouvaient exister dans le reste du monde. Maintenant, il y a un espèce de renversement, comme si c’était seulement par le capitalisme, l’occidentalisation et la globalisation qu’on pouvait aller vers la lutte contre le patriarcat et le corpus hétéro-normatif…C’est quelque chose de très énervant.
ch:mg : À partir de quel sources avez-vous pu construire ce récit ? Vous l’avez dit, la recherche en contexte colonial s’appuie par défaut sur les sources du colon ; or, au regard de cette approche micro-historique et phénoménologique, comment reconstituer la mentalité des colonisés, quand presque toutes les sources sont filtrées par le prisme du colon, d’autant plus que vous vous intéressez aux éléments les plus durs à saisir, à savoir les affects et l’univers mental ?
M. Ranjanoro : Je suis obligée de travailler avec les sources de l’administration coloniale, c’est incontournable. Tous les historiens que j’ai lu ont également travaillé dessus — ça n’en fait évidemment pas des avocats du fait colonial, il y a une réinterprétation qui en est faite derrière. Ces archives doivent donc être relues en prenant en compte leur propres biais, ce que je pense être faisable aujourd’hui, puisqu’on a assez de recul pour produire une lecture critique.
Le soulèvement de Madagascar, Actualités Françaises, 4 décembre 1947. (Source : INA16)
Ensuite, je pense que c’est notre devoir d’apporter un regard critique, un éclairage sur ces sources, qui sont en fait très précieuses : lire des comptes-rendus de plantations ou des procès-verbaux de la police coloniale, c’est vraiment très enrichissant. J’encourage même à faire la démarche de les lire, parce qu’il y a une autocensure qui pousse les gens à croire qu’ils ne pourraient pas y accéder ou les comprendre en tant que non-spécialistes, alors qu’elles appartiennent à tout le monde, Français comme Malgaches. Il y a eu une période où les archives étaient plus accessibles, mais aujourd’hui il y a un resserrement : l’État français rend l’accès plus difficile, ce qui montre en fait qu’il est dérangé par sa propre archive. Il faut désormais prendre rendez-vous, s’expliquer sur les motifs de la demande, montrer patte blanche… Sur place, on dispose d’un laps de temps très court, on ne peut ni photographier ni photocopier ; bref, tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font les recherches. Je pense qu’il faut continuer à réclamer le droit à cette archive, parce que si les jeunes malgaches et franco-malgaches poussent dans cette direction, l’État finira par être obligé de le faire.
En ce qui concerne l’écriture phénoménologique, je me suis fondée sur mon expérience, mon enfance, mon rapport aux endroits que j’ai connu à Madagascar, comme Port-Saïd par exemple. Tous ces endroits que je décris, ce sont des choses que j’ai puisées dans mon expérience du monde.
ch:mg : Cette influence de la culture malgache ne transparaît en fait pas tant dans vos sources stricto sensu, que dans vos inspirations sur le plan esthétique. Madagascar peut justement revendiquer pour elle une tradition poétique et littéraire assez développée ; comment cette tradition a influencé votre travail, encore une fois par rapport à la “froideur” des archives et des sources strictement historiques ?
M. Ranjanoro : Ca a été une peur de ma part de trahir la culture orale malgache en écrivant. Quelque part, la littérature, c’est aussi un héritage que je tire de ma culture française, parce que j’habite en France depuis maintenant un certain nombre d’années, j’ai étudié dans le cadre français, donc il y a forcément une porosité.
Mais c’est vrai que je voulais également rendre compte de l’oralité de la culture malgache, notamment avec la transmission des contes. Ils sont une trace de la mémoire collective, parce que c’est par le conte, la métaphore ou le proverbe qu’on transmet des savoirs immatériels, hérités, aux générations futures — d’ailleurs dans toutes les cultures orales. Et j’ai voulu rendre compte de cela à travers le style du roman : la prosodie imite celle des conteurs, avec beaucoup de reprises, des anaphores, des motifs réguliers, la “nuit qui chuchote”, les “morts qui parlent”, des formules qui s’installent et qui reviennent. C’est quelque chose que j’ai voulu faire circuler dans le texte, de la même façon que j’ai pris une figure, Telonono, qui est à la fois transcrite de manière froide et objective dans les archives mais qui appartient aussi à la légende et au conte.
ch:mg : Dans une de vos prises de paroles autour du livre, vous précisez aussi que vous êtes vous même d’origine betsimisaraka, comme Telonono et Voara, et que c’était dimension très importante de 1947. Quel enjeu particulier il y a à rappeler que 1947 a aussi été une histoire betsimisaraka ?
M. Ranjanoro : Ayant grandi à Antananarivo17, j’ai toujours associé le corpus culturel malgache et la malgachité à la culture merina18, en me disant que les Merina étaient les vrais malgaches. J’ai développé un complexe d’infériorité du fait que je parle très mal le merina19, que dans ma famille on parle betsimisaraka, d’autant plus que je suis sino-malgache. Il y a donc vraiment une forme de fracture identitaire permanente avec laquelle je me débats dans ma malgachité.
1947 m’a permis de me réconcilier un peu avec cela, parce que c’est un épisode qui se passe majoritairement sur la côte est, en territoire betsimisaraka. Si on regarde une carte (voir en dessous) des foyers d’insurrection, c’est ici que le discours anticolonialiste a pris, aux environs de Moramanga. Elles sont aussi les plus soumises au travail forcé par l’administration et à la violence coloniale, parce qu’il y a dans cette région une concentration de plantations, exportant vers la métropole. Or, dans l’après-guerre, la France, exsangue, ne veut surtout pas voir ralentir les rentrées d’argent en provenance des colonies. C’est donc là aussi que le pouvoir colonial a été le plus violent, afin de protéger cette manne financière.

Les principaux foyers de l’insurrection malgache de 1947
(Source : L’Histoire.fr20)
J’ai constaté ainsi que cet épisode historique, central dans l’histoire du nationalisme malgache, est un fait qui concerne en premier lieu les Betsimisaraka. Étant moi-même de culture et d’héritage betsimisaraka, j’ai alors compris que je n’étais pas si périphérique que cela à l’histoire de mon pays. Justement, il y a un centralisme très fort à Madagascar, ne serait-ce que parce que c’est un roi merina qui a soumis les populations provinciales et côtières pour unifier l’île. Ensuite, le découpage territorial de Madagascar aujourd’hui est complètement calqué sur la centralisation française ; on y retrouve un peu quelque chose de l’ordre du mépris parisien pour la province. Or, de la même manière, on sait que l’histoire de France n’est pas qu’à Paris.
Pour revenir sur cette approche du récit, puisque je voulais rendre sensible mon expérience malgache, il était naturel que je parle des régions que je connaissais le mieux. Tout ce qui est lié à mon enfance et à mon expérience, toutes ces sensations, ces forêts épaisses, l’eau présente partout, le climat très fertile mais aussi très rude, avec ces cyclones, la présence de la mer en permanence : c’est le pays betsimisaraka.
ch:mg : Qu’est-ce que ce travail vous a permis de comprendre de la mémoire de 1947, autant en France qu’à Madagascar ? Avec le rapide survol que l’on vient d’en faire, on a l’impression que cet événement n’est quasiment pas connu en France, tandis qu’il est très tabou à Madagascar.
M. Ranjanoro : C’est vrai qu’il y a un silence relatif sur ça, en tout cas dans les familles. Beaucoup de choses ont été écrites par les historiens, mais les travaux n’ont pas forcément été vulgarisés ou diffusés de façon suffisante. Et puis, c’est une démarche d’aller chercher un pavé de 500 pages sur 1947 ! Je pense que mon livre peut servir de porte d’entrée pour ceux qui voudraient une approche moins abrupte, pour aller par la suite vers des ouvrages plus exigeants.
Mon éditrice, Marie-Clémence Andriamonta, s’est retrouvée dans une situation similaire à la mienne lorsqu’elle a sorti son film en 2018 (voir en dessous), et la réception avait été très dure. On lui reprochait d’en avoir trop dit, ou bien pas assez…Donc elle m’a préparée au fait que c’était un sujet épineux, qui suscite des réactions très violentes. Je suis très reconnaissante d’avoir eu quelqu’un pour déblayer le chemin devant moi. Elle m’a aussi aidée pour l’accès aux chercheurs, qui subissent eux aussi beaucoup de pressions, et qui sont donc un peu réticents à partager leurs travaux avec quelqu’un qui n’est pas du sérail. Tout le travail qu’elle a fait, frapper à des portes closes, gagner la confiance de ces gens-là, c’est quelque chose dont j’ai aussi bénéficié.
Finalement, j’ai été agréablement surprise par la réception. Je pense qu’on ne parle plus à la même génération, je m’adresse à des jeunes — malgaches, de la diaspora ou franco-malgaches — qui ont souvent déjà fait un bout de chemin par exemple sur le plan décolonial ou féministe, qui sont déjà dans une posture militante, déjà dans le refus de l’assimilationnisme de leur parents. Il y a eu de très bons retours, surtout de jeunes filles malgaches. Et puis, ce qui m’a le plus touchée, c’est à quel point les femmes de mon âge, et même plus jeunes, se reconnaissaient dans le livre, parce qu’il n’y a pas que le thème de la révolte, il y a des moments très doux aussi. Si on ouvre le livre à la recherche de violence, c’est sûr qu’il y a de quoi faire, mais toutes ces jeunes filles, elles ont surtout vu une histoire d’amitié et de sororité. Cela m’a touchée parce que c’est pour moi un aspect très important du livre. Je n’utiliserais pas le mot résilience, mais, former entre nous des communautés et des rapports doux nous permet aussi d’être plus résistants à cette violence héritée du fait colonial.
ch:mg : En ce qui concerne la France, le livre tout de même a eu une couverture médiatique, notamment dans Le Monde et donc sur France Inter. Est-ce que vous pensez avoir réussi à transmettre également ce point de vue politique, cette volonté de se réapproprier le discours sur le 1947 et sur le fait colonial en tant que descendants de colonisés ?
M. Ranjanoro : Je pense qu’il y a une fenêtre qui s’ouvre en France, malgré tout, pour parler de ça. Elle s’ouvre de façon très étroite, mais il faut s’engouffrer dans la brèche, il y a un vrai enjeu sur le sujet aujourd’hui. Il s’agit d’en parler mieux, en particulier de laisser aussi ceux qui sont concernés, qui sont issus de la colonisation, se saisir du sujet. On n’a peut-être pas l’exposition que peuvent avoir d’autres sujets, mais je pense qu’il y a surtout de la place dans les jeunes médias qui essayent de porter cette voix.
Je ne dis pas qu’il faut se reposer sur nos lauriers : il y a une certaine cartellisation des médias, avec tout un virage vers la droite et l’extrême-droite, autant pour la télévision que pour les éditeurs ou les revendeurs de presse. Il ne faut pas être angélique sur ça. En même temps, le fait qu’il y ait une chape de plomb fait aussi émerger cette volonté de produire du contenu plus politisé, qui laisse parler ceux qui n’ont pas voix au chapitre d’habitude. Cela permet de constituer un paysage résistant, une petite fenêtre de tir, et il faut saisir cette occasion.
ch:mg : En parlant d’espoirs de changement, un mouvement de contestation d’ampleur a émergé au sein de la jeunesse malgache ces derniers jours. Malgré la répression (au moins 20 morts et une centaine de blessés), les manifestants sont parvenus à forcer le renvoi du gouvernement en quelques jours. Or, les revendications étant centrées sur les inégalités sociales et les prix de l’énergie, on pourrait être au premier abord tenté de considérer qu’il n’est ici question que de politique interne malgache ; c’est d’ailleurs cet angle qui constitue l’essentiel du cadrage médiatique. Dans quelle mesure cette actualité pourrait-elle, au contraire, témoigner de cette circularité du fait colonial dont vous parliez ?
M. Ranjanoro : Le 25 septembre, dans la continuité des mobilisations citoyennes de la Gen Z au Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, Indonésie, Népal et tout dernièrement au Maroc et au Pérou, les jeunes malgaches ont pris la rue pour revendiquer leur droit à étudier dans de bonnes conditions. Cette mobilisation historique s’est nourrie d’une indignation légitime face à l’effondrement des services publics, notamment l’eau et l’électricité. Alors que la population paie un coût insoutenable pour des services défaillants, le gouvernement a confié la direction de la JIRAMA21 à Ron Weiss, ressortissant israélien, ancien cadre de l’Israel Electric Company. La collusion du pouvoir malgache avec l’État d’Israël s’illustre à plusieurs niveaux : un partenariat agricole d’environ 90 millions de dollars avec le LR Group pour la création d’agropoles ; la signature en 2021 d’un contrat de cybersurveillance de près de 5 millions d’euros incluant le logiciel espion Predator22, qui place les citoyen·ne·s malgaches et la diaspora sous contrôle électronique.
Ces faits nous rappellent l’importance de la convergence des luttes et notre solidarité avec le peuple palestinien oppressé par l’entité sioniste. Les revendications s’insèrent aussi dans un cadre plus grand dénonçant la corruption, l’indigence politique, la confiscation des ressources par une élite et le rapport de servitude entre le pouvoir malgache et les puissances capitalistes et extractivistes qu’elles soient étrangères (EDF, Total, QMM, Rio Tinto, LR Group, Intellexa, Daewoo…) ou locales. C’est un mouvement internationaliste s’il en est et si j’assiste chaque jour avec effroi à la répression policière héritée de la coutume coercitive coloniale, je ne peux que me sentir fière de ces petits frères et soeurs qui se battent chaque jour pour leurs droits, en résonnance avec toutes ces luttes et en particulier la progression de la Sumud Flotilla en simultané. La convergence des luttes prend un sens particulièrement fort en ce mois de septembre !
ch:mg : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions. Que prévoyez-vous pour la suite ?
M. Ranjanoro : Merci pour vos questions ! Pour la prochaine étape, Latérit, ma maison d’édition, en train de sortir un recueil de contes malgaches. Après, ça sera mon tour. D’ici le début de l’année prochaine, je vais publier un recueil des nouvelles que j’avais déjà publié dans diverses revues, avec quelques inédites en plus. Ensuite, j’attaquerai mon prochain roman. Inch’Allah !
Note de bas de page
- Disponible sur Soundcloud. ↩︎
- La législation anti-avortement malgache étant un vestige du code pénal français. Voir par exemple : Rabenoro, M. (2017). “Du ‘droit de la force’ à la force du droit: Pour la dépénalisation de l’avortement à Madagascar” . Annuaire africain des Droits de l’Homme, 1, 337-356. ↩︎
- Les Betsimisaraka sont un groupe socio-culturel malgache habitant l’est de l’île. ↩︎
- France Inter. (2024, 29 mai). Affaires sensibles : 1947, massacre à Madagascar ou la pacification française [Épisode de podcast]. ↩︎
- Le 29 mai 2024. ↩︎
- La conférence de Brazzaville, organisée en 1944 sous l’égide du général de Gaulle, visait à redéfinir les rapports entre la France et ses colonies africaines après la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle y pose des bases progressistes, mais ambigües : sans pour autant ouvrir la voie à une véritable indépendance, il y amorce indirectement le processus de décolonisation. ↩︎
- Benjamin König. (2025, 15 mai). Kanaky-Nouvelle-Calédonie : une année d’implacable répression coloniale. L’Humanité. ↩︎
- Les multiples référendums organisés en Kanaky (2018, 2020, 2021) sont souvent mentionnés comme autant de démonstrations de la légitimité du maintien français ; pourtant, les résultats de ces votes laissent transparaître d’énormes disparités dans la participation ainsi qu’un clivage clair entre les provinces à dominante européenne et celles à dominante kanak. Voir par exemple : Patrick Roger. (2021, 13 décembre). Référendum en Nouvelle-Calédonie : l’abstention massive confirme les clivages qui traversent l’archipel. Le Monde. ↩︎
- Auteur inconnu. (1947) Prisonniers malgaches membres du MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation malgache) dans la région de Tamatave. Source : France Inter ↩︎
- Libération. (2023, 12 décembre). Photographie publiée sur les réseaux sociaux et extraite de l’article : Les images de Gazaouis dénudés par l’armée israélienne montrent-elles la reddition d’hommes du Hamas ? Libération. ↩︎
- Eugène Lechat pour l’équipement et les télécommunications, ainsi que Xavier Delmote pour l’agriculture. Voir : Le Monde. (1965, 31 août). Le nouveau gouvernement malgache ne comprend que des membres du P.S.D. ↩︎
- Groupe socio-culturel malgache, habitant principalement l’ouest de l’île. ↩︎
- Voir par exemple : Sciences et Avenir. (2025, 22 avril). Madagascar : EDF entre au capital d’un projet de barrage à plus de 500 millions d’euros. AFP. ↩︎
- Voir : WebTV de l’université de Bejaia. (2025, 6 juin). Débat autour du long métrage « Fahavalo Madagascar 1947 » de Marie-Clémence Andriamonta-Paes [Vidéo]. YouTube. ↩︎
- Césaire, A. (1955). Discours sur le colonialisme. Présence Africaine. ↩︎
- Le soulèvement à Madagascar. (1947, 4 décembre). Actualités françaises [Extrait de film]. Institut National de l’Audiovisuel (INA). ↩︎
- La capitale de Madagascar, qui bénéficie d’une forte centralisation administrative, politique, économique et culturelle. ↩︎
- Groupe socio-culturel malgache, habitant en majorité les Hauts-Plateaux et la capitale. ↩︎
- Entendu ici comme dialecte réciproquement compréhensible, et pas comme une langue à part entière. ↩︎
- Carte issue de : Fremigacci, J. (2007, mars). « La vérité sur la grande révolte de Madagascar ». L’Histoire, (318). ↩︎
- Compagnie malgache gérant la production ainsi que la distribution de l’eau et de l’électricité. ↩︎
- Logiciel épinglé pour son utilisation récurrente dans le cadre du contrôle des oppositions politiques et de la presse dans le monde entier, de la Mongolie à Trinité-et-Tobago, en passant par l’Allemagne, ainsi que Madagascar. Voir par exemple l’entretien de Yann Philipin, journaliste d’investigation chez Mediapart : Mediapart. (2023, 3 octobre). Predator Files, comment la France a aidé des dictatures à espionner leur peuple [Vidéo]. YouTube. ↩︎

Laisser un commentaire